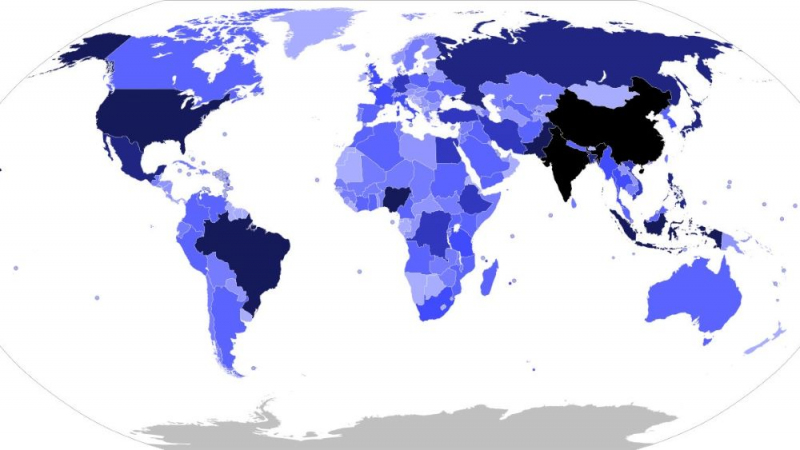
Pour une politique étrangère au service de l’intérêt national
Parmi les quatre (ou cinq, (selon la façon dont on les définit)) fonctions régaliennes dont la Cité est investie, la politique étrangère jouit d’une primauté absolue. Elle est clairement première par son objet, la Cité ne pouvant en effet connaître ni paix civile, ni justice, ni finances ordonnées, c’est-à-dire aucune des composantes de l’ordre, sans lequel ne peut se réaliser le Bien commun, si, au préalable, n’ont pas été établies des frontières sûres. C’est donc aux menaces extérieures, pesant sur la Cité, que la politique étrangère doit faire face.
Quant aux moyens, politique étrangère signifie d’abord diplomatie, mais celle-ci ne peut avoir d’existence réelle, d’efficacité pratique, que si elle dispose de l’ultima ratio qu’est la force des armes ; du temps, pas si lointain où, communiquant la culture avec le savoir, l’école de la République enseignait le latin au collège, les élèves connaissaient tous l’adage « si vis pacem, para bellum », qui apparaissait comme une évidence de simple bon sens[1].
Il n’y a donc qu’une pure analogie de contamination morale à qualifier en bien ou en mal les décisions de politique étrangère, qui ne sont efficaces que par rapport à leur objet ainsi défini, ou inutiles et a fortiori mauvaises, que par rapport à ce même objet ; il n’y a là, il ne peut y avoir là, aucune espèce de morale ce qui est d’un autre ordre. On pense au mot de Chamfort : « On ne joue pas aux échecs avec un bon coeur ».
Pour souligner cette primauté absolue de la politique étrangère, on peut, dans une plus large mesure, suivre Carl Schmitt, selon lequel la spécificité du politique, et ce à quoi se ramènent les actes et motivations qui en relèvent, est la différentiation de l’ami et de l’ennemi. Même si l’on peut mitiger la priorité absolue, établie par le philosophe rhénan, entre les présupposés du politique, c’est un fait que la désignation de l’ennemi, en même temps qu’elle se trouve à la base de l’agir en quoi consiste proprement la politique, rend compte également de l’être politique. Julien Freund, dans son Essence du politique, enseigne qu’« il n’y a de politique que là où il y a un ennemi réel ou virtuel » ; réel ou virtuel, parce qu’il s’agit essentiellement d’une altérité par rapport à soi, n’impliquant donc pas forcément une relation intrinsèquement polémogène. Cette reconnaissance et cette désignation sont un nécessaire et irremplaçable facteur d’union civique, dans son 1984, où il conçoit un gouvernement mondial, Georges Orwell crée de toutes pièces, l’ennemi extérieur, ennemi supposé réel, contre lequel sont organisées et entretenues toutes les haines, cristallisant et orientant contre lui, les aspirations naturelles à la violence. On reste bien ainsi dans le politique comme pluviversum première des essences permettant de définir la nature humaine. Cela dit, dans le monde concret, pour que la désignation de l’ennemi réel (ou d’ailleurs de l’allié) obéisse à la rationalité conforme au Bien commun, encore faut-il qu’elle puisse être effectuée en toute liberté ; et donc que celui ou ceux, à qui incombe cette importante décision, qui engage l’avenir de la Cité, ne fasse pas d’erreur sur l’identité du ou des ennemis potentiels. On en vient donc clairement à la souveraineté car, à l’évidence, seul l’intérêt national peut légitimement dicter sa loi dans la désignation de l’ennemi, et ce n’est évidemment pas au voisin de nous le dire. D’où la nécessité de l’absolue autonomie du choix des alliances diplomatiques, et a fortiori, de la décision de guerre, pour la même raison d’intérêt national ; un tel choix ne saurait évidemment être fait en fonction de considérations idéologiques ou morales, qui ne concernent en rien la politique. Léon Daudet, qui accompagnait son père aux eaux de Lamalou, rapporte les propos de l’historien et linguiste Auguste Brachet, curiste lui-même : « En matière de politique extérieure, je ne hais ni je n’aime. Je regarde où est l’avantage de mon pays, voilà tout ». Restant sauves les sympathies que chacun peut éprouver pour tel ou tel peuple, pour tel ou tel Etat, il y là une excellente anticipation de la formule maurrassienne : « La France, la France seule ! » On peut donc dire que, par sa nature même, la politique étrangère est le lieu éminent de la souveraineté et, de ce fait, la pierre angulaire du Bien commun.
Au contraire, chercher à imposer partout ses propres principes idéologiques, et se donner le droit d’infliger des sanctions à ceux qui ne veulent pas s’y soumettre, prendre parti dans des querelles, sans rapport avec le bien général des gens du pays, prétendre construire un monde meilleur, et, pour ce faire, intervenir dans les affaires des autres, n’est absolument pas l’objet normal de la politique étrangère ; en même temps qu’une confusion des essences (on se reportera aussi à ce sujet au lumineux enseignement de Julien Freund), il y aurait là, avec la manifestation d’une vanité démesurée, un détournement destructeur de la finalité de l’action politique !

Dans son Histoire de deux peuples, Jacques Bainville fait remarquer que, rompant avec la sage et prudente tradition diplomatique de la Monarchie française, la Révolution s’engagea dans la voie périlleuse des guerres idéologiques ; dès lors ‒à l’exception des brèves années de la Restauration et de la Monarchie de juillet‒ « la question des rapports avec l’étranger ne (fut) plus réglée d’après les intérêts de la France, mais d’après des sentiments et des théories ». C’est en application de ce dévoiement que l’on vit un Napoléon III, dévot enthousiaste et borné, de « l’Evangile de Sainte-Hélène », manipulé par Bismarck, favoriser de toute les façons possibles l’unité allemande, après l’unité italienne, conduisant ainsi une politique de destruction de l’équilibre européen, alors fondé sur les traités de 1815 (suite de ceux de 1648) et, en conséquence, d’affaiblissement de la France. En approuvant ardemment cette politique, commente Bainville, qui en juge d’après les résultats qu’elle a eus pour nous, ce n’est jamais « d’aussi bon coeur et avec autant d’irréflexion », que les Français ont crié : « Vive ma mort ! » Inéluctable conséquence de Sadowa ‒résume-t-il‒ « Sedan est la contrepartie de Bouvines ».
Au fait primordial de la souveraineté, avec les conséquences qu’elle entraîne quant aux choix à faire, s’ajoutent deux autres éléments, essentiels à toute politique étrangère digne de ce nom. D’abord, c’est un fait que le péril n’est jamais unique. Par ses actes, ou par ses ambitions annoncées, un ennemi peut se désigner lui-même ; ce fut le cas avec l’Allemagne de Hitler qui, dès 1925, par son Mein Kampf, fit clairement savoir, face à l’aveuglement criminel des pacifistes à la Briand ou à la Blum, quel sort il entendait réserver à la France du traité de Versailles. Mais il faut surveiller aussi celui qui peut éventuellement nuire ; et comme, répétons-le, la politique n’a rien de commun avec la morale, c’est bien sur l’intérêt du pays et sur lui seul, que les conflits, comme les alliances, peuvent se fonder. Une chose est de mal évaluer cet intérêt à un moment donné, Louis XIII en 1632, Louis XV, lors de la première guerre de sept ans (selon Bainville), car on peut alors, se reprendre, mais c’en est une d’une tout autre gravité, de partir dans des fantasmagories idéologiques. Pour la même raison et dans la même logique, le second élément est qu’alliances et défense ne se préparent pas seulement pour le lendemain imminent, mais doivent aussi, pour la vie de la Cité, se projeter dans la durée ; si la communauté politique est faite pour exister dans l’espace, elle l’est aussi pour durer dans le temps. Et, on le sait : les erreurs se payent pendant longtemps, les erreurs politiques plus longtemps que les autres !
A partir de ces considérations générales la question qui s’impose aujourd’hui est de savoir où en est la France dans laquelle nous vivons, en matière de politique étrangère. La réponse est qu’à peine plus d’un siècle et demi après Sadowa, sous nos yeux, au mépris de l’expérience historique, les gouvernements républicains se succèdent sur la voie de la trahison de nos intérêts et que les Français n’ont pas renoncé aux illusions mortifères, qui ont produit tant de désastres. Aussi, les Sedan qui se préparent sous la conduite des mauvais chefs qu’ils se sont donnés, n’ont pas fini de les ruiner, de les tuer ; en cette fin de l’an de disgrâce 2022, on peut redonner la plus fâcheuse actualité à la question toute simple posée par Maurras, dans l’Examen introductif de l’édition définitive de son Kiel et Tanger : « Oui ou non, la République peut-elle avoir une politique extérieure ?»
A l’évidence, le manichéisme puéril qui semble aujourd’hui la base de toute réflexion de politique étrangère, et dont on obnubile les cerveaux dociles des Français, couplé avec la servilité face aux idéologies dominantes et la soumission à l’Alliance atlantique, mettent la France de Macron dans l’incapacité de servir le Bien commun. Il suffit d’entendre ce lamentable personnage ‒le même qui, tout récemment, appelait de ses vœux l’instauration d’un « ordre mondial unique »‒ inciter les Français à « payer le prix de la liberté » face à « l’attaque brutale » attribuée à Poutine, et de « payer le prix de la liberté » pour soutenir l’Ukraine. Les épigones macronards ne sont pas en reste : l’incompétent patenté, promoteur des sanctions qui devaient couler l’économie russe, interroge gravement : « Peut-on laisser un pays attaquer un autre pays ? C’est ce qu’a fait la Russie » ; sa nullissime cheftaine dégoise avec des trémolos émus : « La défense de nos valeurs a un prix » ; de leur côté, les médias dominants continuent leur communication sentimalo-belliqueuse à sens unique ; et une bêtasse de presse audio-visuelle regrette que les Français ne soient pas assez enthousiastes pour s’engager militairement en faveur de l’Ukraine.
Il faut savoir raison garder. La liberté des Français est-elle menacée par la Russie ? Est-ce effectivement la leur dont ils doivent payer un prix quelconque pour l’assurer, ou bien doivent-ils payer eux-mêmes, pour l’assurer à d’autres ? Les Français sont-ils chargés d’un rôle de juge et de gendarme pour trancher sur la légitimité ou la non légitimité de telle attaque d’un pays par un autre, de juger sur le fait de savoir qui a raison ou tort dans un différend international qui ne les concerne en rien ?
Moins borné que ses successeurs, dont certains poussèrent l’insanité jusqu’à un terme à peine croyable, l’ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, déplore, à juste titre, cet « humanitarisme médiatisé », obstacle majeur, selon lui, à toute politique étrangère véritable.
Quels dangers mortels font au contraire, courir à la France, les élucubrations irresponsables des politicards de la république ! On regrette que ce ne soit pas un Français de la lignée des réalistes qui nous guidèrent jadis, mais le Premier ministre hongrois qui, dénonçant la position agressive de l’U.E, exprime la position la plus raisonnable : « La politique de sanctions est un pas vers la guerre. Quiconque intervient ainsi prend position, et c’est un autre pas vers l’une des parties en guerre, en d’autres termes en direction de la guerre. » Or, on le constate avec une résignation horrifiée : les conséquences, catastrophiques pour les Français, des sanctions économiques prises contre la Russie ne semblent même pas avoir fait s’interroger quiconque, sur la capacité des moyens militaires dont disposerait la France en cas de conflit ouvert. L’inepte république de 2023 fait, avec l’internationalisme européiste et otanien, inévitablement penser à celle de septembre 1939. Aussi, est-ce bien, hélas, par la négative, qu’en 2023, il faut répondre à la question posée par Maurras en 1927.
A l’opposé, il est clairement indispensable de revenir au politique comme essence, et à la politique comme agir, c’est-à-dire de se soumettre à la nécessité de renouer avec une vision géopolitique des relations internationales, dans un cadre largement pluraliste, et ce, par rapport au seul intérêt français.
L’instauration d’un ordre mondial unique ( que souhaite qui ???), ferait ainsi sortir l’homme de ses voies, et le condamnerait à mort, à moins que ne se reconstitue plus ou moins invisiblement ‒c’est, selon Julien Freund, de l’ordre de la nécessité‒ des structures politiques parallèles.
Philippe Champion
[1]Comme l’ordre moral s’est glissé partout, la grammaire latine préféra un jour : « Si vis pacem, cole virtutem ».


